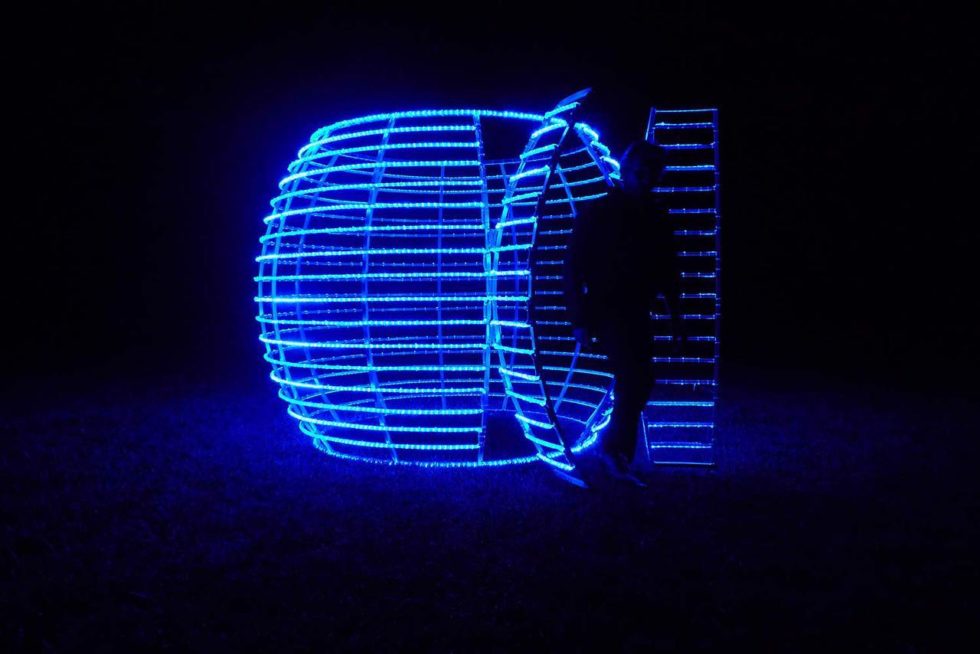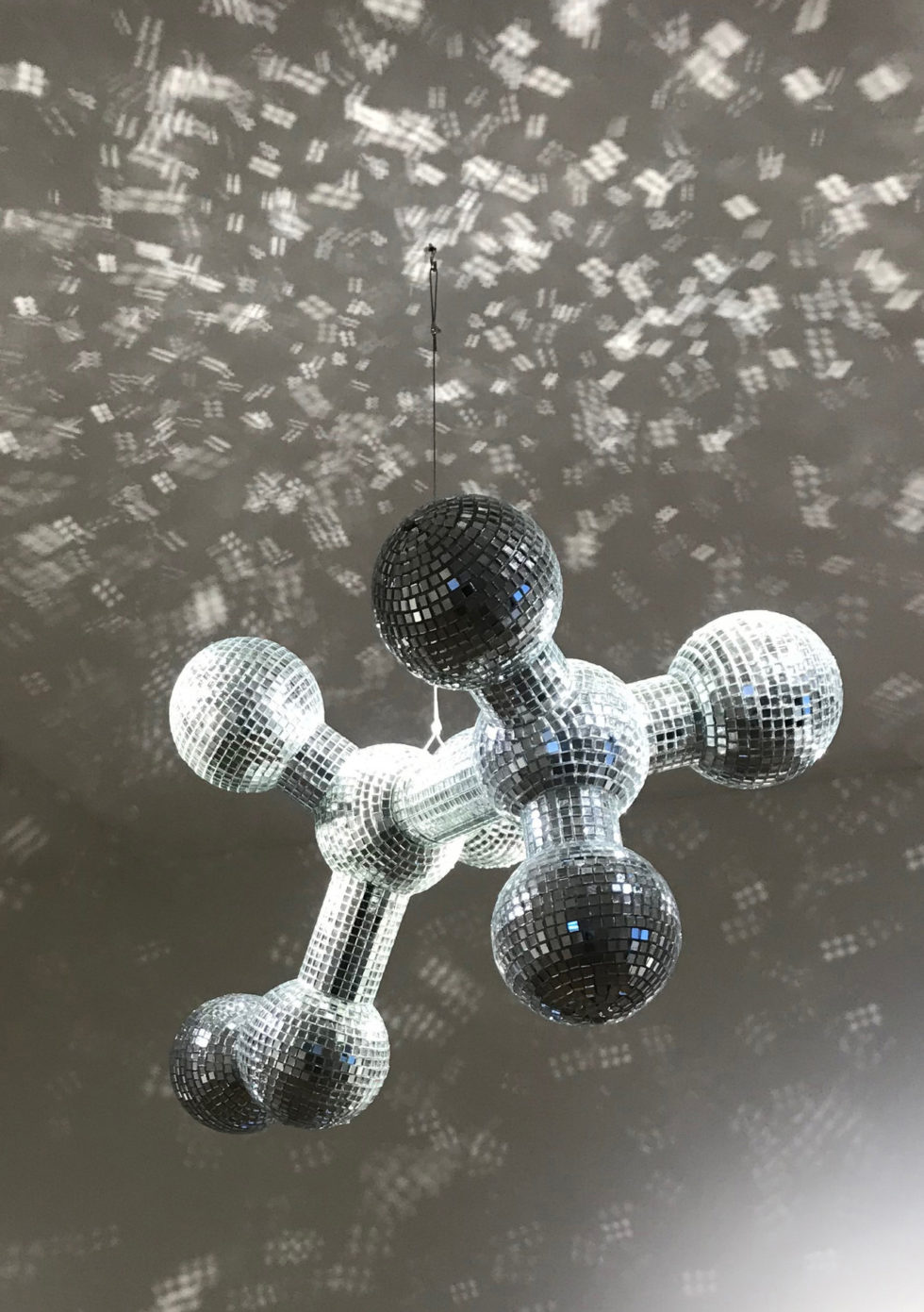Jeanne est un prénom qui renvoie, dans la sphère culturelle française, à la combattante pucelle, à la pure, à la folle, à l’ennemie des anglais. Héroïne ré-appropriable par excellence, Jeanne est celle, corps brûlé, bouche scellée, à laquelle on fait dire. L’énormité de son martyr est tel qu’il impose un respect, un frisson dans l’échine. Ceux qui parlent pour elle ne peuvent être contredits, qu’ils en fassent une sainte laïque, le symbole d’un nationalisme fier et combattant, du régime de Vichy, des gaullistes, une pauvre paysanne brûlée par l’Église, une féministe. Ils ne peuvent être contredits parce que, parlant, faisant de Jeanne ce qu’ils décident, ils s’appuient sur cette souffrance à elle, vécue par elle, qu’ils s’approprient tandis que les cendres mêmes ont disparu. Sur le plan étymologique, le prénom Jeanne renvoie à l’hébreu Yehohanan, signifiant « Dieu pardonne ». De Jeanne donc, on attend beaucoup. Et si l’entrée en matière par le prénom, donnée que chaque individu se voit imposée à la naissance et qui sera toujours un « ce qui me vient de l’extérieur et que je dois m’approprier », s’applique au cas de Jeanne Susplugas, c’est qu’il m’aurait été impossible autrement d’amener la formule de « facture classique » qui me vient systématiquement à l’esprit lorsque je pense à elle, qui est d’emblée un contresens, et qui s’explique par son aura, par sa formation universitaire, par sa taille, par la netteté des images qu’elle produit, par leur densité. Pour autant, et pour épuiser la charge de la formule, « facture classique » se relie aussi à Jeanne telle que nous l’avons vue, une réduction: nous qualifions de « facture classique » des entités dont nous pensons qu’elles sont le fruit d’un code culturel facile à comprendre, à résumer, à ré-utiliser. L’abord du travail de Jeanne Susplugas doit se faire ainsi, en appréciant une forme de facilité d’accès. Je connais, je comprends, je lis : maison, masque, pilules, néons, mots, femme, nature morte, céramique, photographie, drive thru, États-Unis, Paris mais/et c’est ailleurs que tout se joue. Un ailleurs dont l’accès nous est justement rendu possible par ce qui est venu juste avant. Une nature morte, par exemple, qui se dit en détail.
Ça me rappelle cette citation que j’ai lu dans la Méthode Schopenhauer d’Irvin Yalom, « quand on se réveille découragé au beau milieu de la nuit, les ennemis qu’on avait terrassés il y a bien longtemps reviennent nous hanter. » Cette citation est attribuée à Nietzsche mais je n’ai jamais retrouvé la source, l’originale.

Clare Mary Puyfoulhoux je veux bien qu’on se demande comment et pourquoi voir les gens sur écran est moins vrai que leur écrire qui n’est pas nécessairement moins vrai que les voir en chair.
Pour commencer, quand j’ouvre ton wikipedia j’adore:
installationniste
c’est génial,
c’est quoi?
Jeanne Susplugas Je viens de regarder, j’avais oublié. Maintenant je me souviens qu’à l’époque ça m’avait fait rire. J’ai l’impression d’être une épicière. Ça me fait penser aux marchands. J’ai longtemps travaillé avec une galeriste sans galerie, et quand je parlais d’elle, je disais « marchande ». J’étais mal à l’aise. Je l’imaginais en train d’installer, justement, son étal au marché, tôt le matin. Et quand tu l’imagines, ça donne juste envie de rire.
C.M.P. Je vois tout à fait, parfaitement imagé. J’entendais de mon côté quelque chose de l’illusionniste (Houdini) mais qui me renvoie aussi à ton épicière et à ton malaise. Alors, peut-être: artiste c’est quoi? Et je trouve ça d’autant plus « quoi » que je me souviens de toi racontant le étudiante d’abord, théorique d’abord; et puis c’est un homme, un professeur (?), une figure d’autorité, qui t’appelle, te donne le droit, t’invite à être ce que tu pratiques déjà.
Mon souvenir est délibérément flou – comme ça c’est moi aussi qu’il pointe du doigt.
Je débusque le lièvre du être / faire parce qu’il m’intéresse évidemment, moi qui ne suis pas critique (mais labellisée). Et quand je dis « parfaitement imagé », ça me renvoie au présent: de plus en plus, en ce moment, je cherche à comprendre l’image.
J.S. L’illusionniste, tout de suite, ça fait un peu plus rêver.
C’est vrai que je m’étais orientée vers la théorie, pas par compromis mais parce que je m’étais réellement passionnée pour l’Histoire de l’art et je pensais que les deux, la création et la théorie, pourraient être menées de front. C’est ce que j’ai fait. Après, c’est une question de rencontres, que l’on provoque ou pas; de mains tendues. Mon directeur de recherche a bien sûr eu un rôle important car il était une des clés. Continuer dans cette voie toute tracée, ou oser faire un pas de côté. Un grand pas à l’époque. Il faut remettre en perspective. Même pour lui, d’une certaine manière, c’était une responsabilité.
aparte: échanges de courriels
C.M.P. Je me demandais comment tu te sentais et j’ai lu ça, en partie seulement, mais ça m’a rappelé notre conversation de bistrot. J’ai eu l’intuition qu’il y avait un lien fort, et je me souviens que, dans les textes que j’ai pu lire te présentant, revient souvent le couple « addiction-aliénation ». Quand je te vois, ce sont des mots que je n’arrive pas, que je ne veux pas, ne peux pas coller à quoi que ce soit de toi puisque, malgré une présence de femme, d’adulte, tu fais très blanche colombe. Et, si on dépasse le côté trivial de ma remarque, je me demande si l’illusionniste/
J.S. Le texte que tu m’as envoyé est très fort. Je ressens ses mots. Certains phrases sont troublantes par rapport à mon travail. Le passage sur « la petite dame » qui en « Marre de devoir subir et sourire, en même temps ». Marre d’être « la petite dame », marre que l’on ne me regarde pas quand on me parle, marre de ne pas être entendue et de devoir suivre, suivre, m’adapter. Marre. Je pouvais dire que j’en avais marre, on pouvait le dire avant que l’on nous fasse taire.
J’ai réalisé une vidéo qui s’intitule « Ma petite dame », un texte que j’avais commandé à Basile Panurgias qui fait étrangement écho. ( Aussi parce qu’elle est étrangère et qu’on la renvoie sans arrêt à ses origines! ) Avec la même comédienne, Manesca de Ternay, j’ai réalisé d’autres vidéos, notamment There’s no place like home et Les petits indiens (texte de Marie-Gabrielle Duc) qui prennent une autre dimension dans ces temps confinés. Et puis ça fait écho à cette maison qui peut se retourner contre nous. Dans ce moment très troublé, je la sens bienveillante. Elle ne l’a pas toujours été, et je savoure ce calme non conflictuel, sans ostentation, par peur de le perdre à nouveau. Mais mon travail, en si évidente résonance, résonne aussi dans ma tête et dans mon corps. C’est presque trop, tant de monde confronté au même moment à ces questions qui m’habitent, sans jeu de mots, au quotidien. Est-ce qu’ils.elles partagent mon expérience? me la volent?
J’aimerais être cette blanche colombe que rien n’atteint. En prenant de la hauteur (et qui mieux qu’une colombe?) on peut essayer de rester à distance. C’est ce que je pratique en creusant du côté des interstices, de la limite, avant le basculement potentiel. Rester chez moi, le plus possible ce serait un peu comme se découper du fond, observer le monde sans être atteinte par les postillons. Quelque chose de littéralement salvateur aujourd’hui, mais qui est une image vraie le reste du temps. Finalement, j’ai l’impression, comme dans le texte de Pérola Milman, que je suis confinable et confinée, comme une métaphore de cette femme qui sourit alors qu’elle voudrait crier l’injustice de sa condition comme celle du monde.
C.M.P. J’ai repensé à ta maison cette nuit, revu l’image du masque d’éponge rose pâle qui est l’image par laquelle je t’ai découverte, qui m’a fait penser peau, chair, peur, menace, dessin animé, totem, rituel. Et j’ai repensé à ta maison en me réveillant ce matin, à ce qu’elle contient et déborde, rejette, exhibe. J’en suis venue à la peau. Enveloppe, autre maison. Tout cela dans ton travail, qu’évidemment je connais mal. Une maison dont on ne montre pas les organes – là ce sont les noix en céramique qui ont toqué dans mon crâne. Mais j’ai pensé que ta maison n’était pas tant menaçante, ou accueillante, qu’à mettre en écho avec la peau. ( Faute / lapsus matinal: j’ai failli mettre égo à la place d’écho.)
Quant à la vidéo, Ma petite dame, Duras était partout dans ma peau. Et évidemment c’est une horreur – ou un miracle – comme ça résonne ton No place like home. Les petits indiens quant à eux m’ont propulsée dans le passé. Mille histoires à raconter. Mais surtout, Bruce Nauman dans ma tête, comme on sortirait le diable de sa boîte – ça te fait tout à coup moins colombe, et surtout moins strictement femme. Quand je dis ça, je dis: la puissance avec laquelle No place like home m’atteint me rappelle la puissance avec laquelle certaines pièces de Nauman m’ont atteinte, directement percée (mise à jour ou ajournée, j’hésite pour la formule). Touchée, à l’intersection entre les données qui me composent et la force qui me constitue mais échappe aux mots. Ensuite, disons que j’ai très envie d’éviter d’utiliser ce confinement, de contourner la parole sur, de ne pas l’adresser, comme si c’était vulgaire et sale de l’adresser – j’entends: je me découvre contenue, le confinement découvre cela pour moi. Pourtant, on y est et y étant, c’est dedans, depuis lui, que notre échange résonne.
J.S. « Découverte » alors qu’il s’agit bien de couvrir, se couvrir le visage. Geste interdit, on ne peut pas dissimuler son visage dans l’espace public. Mais là il s’agit bien du privé, un masque acheté à Tokyo pour se détendre, être toujours plus conforme à une certaine image sociale. Le masque raconte beaucoup de choses. Il fait rire, ou peur. Aujourd’hui, le masque est résolument politique. Il sauve, inquiète, est objet de tous les débats, de transactions plus ou moins honnêtes. Il est objet de pouvoir. A l’époque, je pensais qu’il me ferait rire mais il était terrifiant par son ridicule et par ses références au cinéma. D’horreur. Il fait référence à l’intime, ce que l’on cache un peu, par pudeur, honte. Derrière une porte de salle de bains, derrière une porte de maison. Il est question de porte, de ce qu’on laisse voir ou pas. Le masque est enveloppe, une seconde peau. Mais il est aussi masque social, sait-on jamais à qui l’on a affaire ? Mon installation All the world’s a stage fait référence à ce que l’on cache, derrière les fenêtres de la maison, mais aussi consciemment, inconsciemment dans son for intérieur. Il est aussi question d’intérieur et d’extérieur. Comme cette maison qui déborde d’objets. A l’origine, des objets béquilles que l’on prendrait en cas de fuite avec l’idée de ne jamais revenir. Mais ces objets se muent aussi en autant de petits boulets qui nous empêchent d’avancer, de nous alléger, de nous envoler. Dans ce moment de confinement, on est quand même bien content d’être entouré de nos petites béquilles. Elles nous aident, nous rassurent. Pourtant je ne peux m’empêcher de trier, ranger, me débarrasser. Comme je ne peux m’empêcher de revisiter mon propre travail. Je suis d’accord avec ce qu’écrit Andrew Russeth, nous sommes prêts mais surtout parce que finalement, qu’est-ce qui change réellement pour nous ? nous sommes dans une forme de précarité – et ce n’est pas une plainte mais un constat – et notre quotidien consiste à nous adapter, nous remettre en question. C’est en ce sens que nous serons prêts.
C.M.P. Ce sont des nuits étranges. Je dors en cauchemar ou suis éveillée en boucle avec la sensation du piège, et que ce piège n’est pas à proprement parler le confinement, mais l’être contenu.
Les épiphanies des nuits sont très difficiles à rendre au réveil. Elles perdent leur clarté avec le jour. Je pensais à la responsabilité politique des hommes et des femmes, et mon épiphanie, cette nuit, avait trait à la banalité du combat. A ce qu’il fallait encore ressasser de » je ne ferai pas », « je ne laisserai pas ». Souvent, j’ai l’impression qu’être ensemble est un leurre, une illusion. Que chacun vit enfermé dans une projection de ce qu’il est, dépendant de regards qui n’existent même pas et qu’à l’intérieur de ce film, l’autre est un figurant qui a fonction à entretenir cette image qui sans lui ne tiendrait pas. Et ton masque vient là pour moi. Moins d’ailleurs dans la matérialité angoissante de sa texture et de sa forme que dans les mains très belles, obéissantes, qui placent l’objet devant le visage, que dans la délicatesse floutée de la chair au second plan. Quant au noir des fentes ou de ce qui surplombe (chevelure?): abyssal de l’angoisse. Aussi, j’ai pensé qu’il y avait beaucoup de frontal dans ce que tu fais, mais un frontal efficace en ce qu’il n’est pas vindicatif.
J.S. Moi aussi, depuis le confinement, je fais des cauchemars, qui se floutent dès le réveil. Ça me rappelle cette citation que j’ai lu dans la Méthode Schopenhauer d’Irvin Yalom, « quand on se réveille découragé au beau milieu de la nuit, les ennemis qu’on avait terrassés il y a bien longtemps reviennent nous hanter. » Cette citation est attribuée à Nietzsche mais je n’ai jamais retrouvé la source, l’originale. Être ensemble est une forme de leurre, mais nécessaire. Le masque est aussi un leurre. Que cache t-il ? Mon travail est en effet assez frontal, lisible de manière immédiate. Surtout pas vindicatif. Me venger de quoi ? La vengeance me semble parfaitement inutile.
L’entretien, qui s’est composé d’extraits de mails qui se sont échangés comme cela arrive entre les gens, se termine. Les mails s’espacent. Quelque chose a été dit. Et je reviens. (Je: C.M.P.) Les échanges avec Jeanne n’ont pas établi cette complicité cynique, de mise à distance du réel, qu’il m’arrive si souvent d’utiliser pour me rassurer. Nous avons été, en lien, dans ce frontal non vindicatif que je pointais.
C.M.P. J’y réfléchis, encore, parce que c’est vraiment je crois une chose qui me touche dans ton travail, ce frontal qui n’est pas ironique, ou vengeur. Il importe à mon sens de dire qu’il n’est pas non plus soumis (d’où la puissance de tes femmes en vidéo, de ces pilules qui habitent tes images sans s’y exhiber ou y gémir, de cette maison qui s’envole et déborde, qui reste close, caricaturale et/ou fonctionnelle). Le tout: offert sans être à disposition ou, plus précisément encore, à disposition sans être exploitable, use-able, souille-able. Ni le cri qui vient signaler, ni le silence étouffé. J’ai envie de préciser ce regard, parce qu’il est là où je suis en respect devant ton geste.